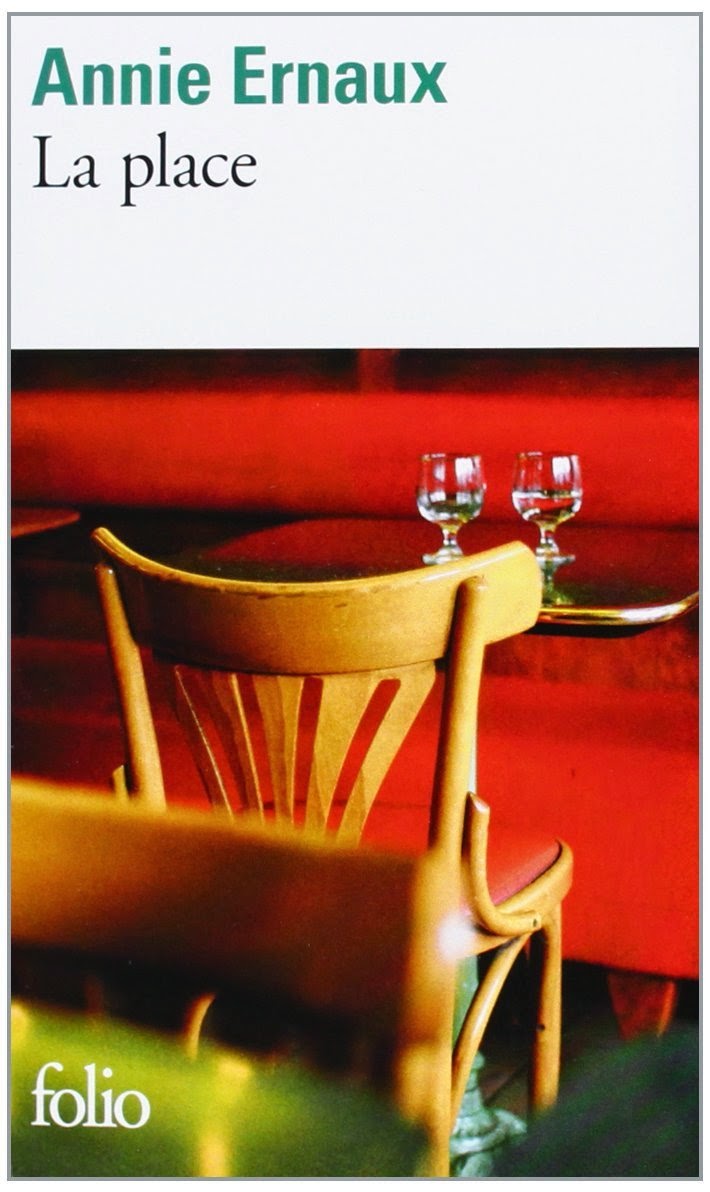(( Ce
texte est un essai de lecture écrit dans le cadre d'études
universitaires, et qui avait pour sujet imposé le livre La place,
de Annie Ernaux. ))
Annie
Ernaux écrit La
place
en 1983, à l'âge de 43 ans. C'est son quatrième roman, et ce livre
occupe une place particulière dans son œuvre, car il marque un
tournant dans sa carrière littéraire: alors que ses romans
précédents mettent en scène des héroïnes fictives (quoiqu'assez
proches de l'auteur), celui-là parle ouvertement d'elle et de sa
famille. Les livres qu'elle écrira ensuite traiteront toujours cette
matière autobiographique, et dans le même style, cette « écriture
plate », comme elle l'appelle elle-même. Remarqué par le
public, La
place remporte
le Prix Renaudot en 1984.
L'histoire est assez simple:
à la mort de son père, Annie Ernaux décide de raconter la vie de
celui-ci, ainsi que leur relation, qui, elle l'explique au cours du
roman, s'est transformée en « distance de classe », en
« amour séparé ». Elle tente ici, en racontant leur
histoire, de revenir sur cette séparation, sur l'origine de cet
éloignement qui est lié à l'évolution sociale qu'elle représente
au sein de sa famille, par son parcours professionnel, son mariage et
son nouveau mode de vie.
Le
livre s'ouvre sur l'examen final aux épreuves du CAPES, quand
l'auteur apprend qu'elle est reçue pour être professeur. Puis, deux
mois plus tard, son père meurt, et ces deux souvenirs se confondent
dans son esprit. Annie Ernaux nous livre les premiers instants de
cette mort, avant de retracer l'histoire de son père, depuis son
enfance, jusqu'à cet instant. On peut noter que ce livre assez
court, une centaine de pages, présente une structure originale, sans
chapitre, où les silences sont marqués par des blancs et où la
voix de l'auteur se fait entendre dans des passages où elle arrête
le récit pour nous faire part de l'expérience qu'elle vit en
écrivant ce livre.
On
pourrait imaginer par cette brève présentation que le récit qui va
nous être fait sera très touchant, et que l'on y trouvera toutes
les marques des émotions de l'auteur. Il n'en est rien, et c'est là
le paradoxe de l'écriture d'Annie Ernaux. Elle nous montre cette
vie, qu'elle partage et dont elle est issue, de manière très
détachée, avec un regard qui se veut « objectif ».
Pourtant,
l'effet produit sur le lecteur est puissant, et l'on ne manque pas
d'être ému à la lecture de ce livre. Ce sont les deux aspects de
l'œuvre que nous allons développer, cette écriture paradoxale, et
la forte portée émotive qu'elle contient néanmoins.
Annie
Ernaux, pour parler de la mort de son père, raconte comme vus de
l'extérieur les gestes de sa mère et de ses proches, les détails
administratifs et techniques et même la compositions des repas. Le
lecteur s'ancre dès les premières pages dans une narration à la
temporalité plutôt lente, et qui semble rester à la surface des
évènements, mettre les sentiments de côté. Les faits, seulement
les faits, pourrait-on lire en filigranes de ces premières pages.
Même
lorsqu'elle explique sa volonté d'écrire ce livre, elle le fait de
cette écriture économe, qui refuse tout pathos et tout lyrisme.
D'où
vient cette langue plate qu'elle utilise pour la première fois,
puisque ses trois romans précédents ne sont pas écrits de cette
façon ?
La
question du langage est centrale dans la vie de famille d'Annie
Ernaux enfant. La langue est une des marques visibles de « la
place » que chacun occupe au sein de la société, et de ce
fait, notre langage porte en lui les traces de nos origines, et de ce
que nous sommes.
Très tôt une barrière s'élève entre le père et sa fille, quand, enfant, Annie Ernaux veut reprendre son père sur son langage, qu'elle juge incorrect. Par mimétisme avec son institutrice, elle veut le corriger, consciente des difficultés à apprendre une langue normée quand on ne la pratique pas au sein de sa famille.
Très tôt une barrière s'élève entre le père et sa fille, quand, enfant, Annie Ernaux veut reprendre son père sur son langage, qu'elle juge incorrect. Par mimétisme avec son institutrice, elle veut le corriger, consciente des difficultés à apprendre une langue normée quand on ne la pratique pas au sein de sa famille.
Cette
langue paternelle, dont on apprend qu'elle est mêlée de patois, est
vécue par lui comme une marque humiliante de sa condition modeste.
Un passage nous éclaire sur ce point, lorsque l'auteur raconte
l'habitude de son père de transformer son vocabulaire lorsqu'il
s'adresse à quelqu'un dont la condition lui paraît supérieure à
la sienne, alors que pour s'adresser aux siens il reprend sa langue
« naturelle », sa langue « d'origine »
pourrait-on dire. L'auteur avoue d'ailleurs que cette langue
paternelle est sa première expérience de langage, et qu'elle
n'imaginait pas que l'on puisse naturellement s'exprimer « dans
un langage châtié ».
Lorsqu'il
se fait ainsi reprendre, son père refuse les corrections de sa fille
et entre même dans une « violente colère » lorsqu'elle
lui fait remarquer que les expressions qu'il emploie « n'existent
pas ». Le nouveau langage qu'elle apprend à l'école est donc
cantonné à ce lieu et n'entre pas dans la maison, tandis que le
langage de la famille est déprécié et nié.
Pourtant, une contradiction naît également à propos de la langue et nous révèle la figure ambivalente de ce père: il reprend lui-même sa fille lorsqu'elle ne s'exprime pas suffisamment correctement et utilise des abréviations ou des mots d'argots.
Pourtant, une contradiction naît également à propos de la langue et nous révèle la figure ambivalente de ce père: il reprend lui-même sa fille lorsqu'elle ne s'exprime pas suffisamment correctement et utilise des abréviations ou des mots d'argots.
Dans
cette relation au langage se trouve la clef même de ce qui se dénoue
jusqu'à la séparation entre le père et la fille: il souhaite
qu'elle accède à un meilleur langage que le sien -et ici le langage
représente tout un milieu social, mais lorsqu'elle se l'approprie et
le lui renvoie, il ne peut l'intégrer, le faire sien, et s'en
détourne douloureusement. L'auteur écrit d'ailleurs que son père
était un « passeur entre deux rives », celle de la
maison et celle de l'école. Loin de vouloir l'empêcher d'apprendre,
il l'a d'abord encouragée à être une bonne élève, avant d'être
finalement dépassé par les aspirations nouvelles de sa fille.
En
choisissant de faire des études, de travailler dans l'enseignement,
de faire de la langue son métier, l'auteur réalise donc d'une part
un souhait de son père, d'autre part une trahison envers lui et son
milieu.
Ce
sentiment de trahison et la culpabilité qui en émane sont cruciaux
dans cette œuvre, que l'on pourrait lire et interpréter de cette
unique façon, comme nous y invite l'auteur elle-même par la
citation de Jean Genet qu'elle place en exergue de son roman: « Je
hasarde une explication: écrire, c'est le dernier recours quand on a
trahit. »
Plus
loin dans le texte, elle dit: « J'écris peut-être parce qu'on
n'avait plus rien à se dire. »
On
peut donc déduire que l'objectif de ce livre n'est pas simplement de
raconter la vie de ce père aimé mais lointain, mais de renouer un
ultime lien avec lui, de rendre hommage à sa mémoire, de réparer
la trahison qu'elle fait en quittant son milieu pour un milieu qui a
dédaigné les siens, auxquels ils n'avaient pas accès.
La
langue avec laquelle elle racontera son père doit donc être fidèle
à cette mémoire.
On
apprend au cours du roman que l'auteur a d'abord voulu écrire une
fiction dont son père aurait été le héros, mais que cette
tentative a échoué et l'a même emplie de « dégoût ».
D'une certaine manière, l'auteur n'a pas choisi volontairement cette
économie de la langue: elle s'est imposé à elle.
Et
c'est finalement d'une écriture « plate » qu'elle va
mener son récit, écriture à laquelle elle n'est pas étrangère
puisque c'est la langue avec laquelle elle pouvait encore communiquer
avec les siens, pour leur annoncer certaines nouvelles importantes
par écrit, et probablement même à l'oral, puisque, ne parlant plus
les mêmes langages, il leur a fallu trouver une langue commune pour
continuer à échanger, aussi peu que ce fut.
Puisqu'il
lui est impossible de revenir à son langage d'enfant à laquelle
elle n'a plus accès, pour raconter son père sans le trahir à
nouveau, Annie Ernaux utilise donc son écriture de fille-adulte.
Elle s'inscrit dans cette relation séparée en employant le seul
langage qu'il lui reste pour atteindre son père, un langage défait
des figures de rhétoriques bourgeoises qu'elle a apprises, qui sont
maintenant les marques de son langage à elle.
Cette
façon de raconter sous l'angle de faits, plus que de souvenirs est
probablement aussi influencé par la démarche qu'elle expose dans le
livre: il a été difficile pour elle de faire appel à ses propres
sensations, et c'est plutôt en voyant d'autres familles, d'autres
situations similaires qu'elle a pu ré-susciter son passé.
Ainsi,
en racontant son histoire, elle raconte aussi celles de tout un
milieu social auquel elle n'appartient plus, mais qu'elle reconnaît
et qui continue de la toucher.
Et
c'est sûrement là une autre clef qui nous permet de comprendre
comment une écriture si peu lyrique ou pathétique parvient à
toucher le lecteur. Car loin de nous laisser froid, ce livre nous
ouvre la porte aux sensations vécues par l'auteur et par sa famille
non pas en nous les narrant, mais en les suscitant en nous (souvent
par le biais de litotes), au travers des situations décrites.
Ainsi,
le burlesque, la tristesse, ou la gêne s'emparent de nous au fil des
pages, et l'on traverse la vie de la famille comme si l'on y était,
par petites touches entrecoupées d'ellipses.
Le
lecteur, d'une certaine façon, est laissé libre de se retrouver ou
non dans ce récit, de remplir les creux de l'écriture par son
expérience personnelle au sein d'une famille, d'un milieu social qui
lui sont propres.
L'œuvre
d'Annie Ernaux prend donc un nouveau tournant, que l'on peut
qualifier de sociologique puisqu'elle décrit avec précision des
membres de la société, à partir de ses observations. Cet aspect
sociologique de l'œuvre est d'ailleurs accru par les actes que
posent ses parents pour enrayer ou confirmer le déterminisme lié à
leur milieu ouvrier. C'est au travers de ces gestes pour sortir de
leur condition, ou s'y maintenir, que nous est donné à voir la
friction des différents corps sociaux, et ce qui peut naître de
cette confrontation.
Sans
porter de jugement de valeur sur le mode de vie de ses parents, elle
explique vouloir en montrer les joies, mais aussi l'aliénation, et
son écriture « objective » permet la réflexion, loin
des revendications partisanes. Pouvons-nous nous défaire du
déterminisme lié à nos origines ?
Oui,
pourrait-on avancer, puisque l'auteur elle-même a finalement pu
accéder au monde bourgeois étranger à ses parents. Mais cela ne
s'est pas fait sans un sentiment de trahison et de culpabilité
qu'elle ne ressentirait pas si elle y était née. Elle porte
toujours en elle la trace de ses origines, sur lesquelles elle
revient encore avec ce livre, et ceux qui suivront.
Annie
Ernaux, en essayant de nous montrer les faits, les actes, apporte par
ce « regard extérieur » une universalité nouvelle à
son œuvre, capable d'entrer en résonance avec le lecteur, de le
toucher, et de l'amener à réfléchir sur les clivages sociaux de la
société, que, d'une certaine façon, chacun d'entre nous porte en
soi.
Cette
langue plate à fonction informative qui n'était qu'une
communication basique entre l'auteur et ses parents devient un mode
d'écriture qui élargit sa propre histoire et suscite des émotions;
on peut dire, d'une certaine manière qu'elle a transcendé le
langage « dévitalisé » qu'elle employait avec son père.
En
voulant renouer et réparer cette relation douloureuse, elle se fait
l'ambassadrice du milieu ouvrier, et donne à voir la difficulté
d'être confronté à deux milieux sans que l'un ne juge l'autre,
qu'il soit ouvrier ou bourgeois.
Par
le jeu de transparence auquel elle se prête, l'auteur nous livre
également les épreuves de l'écriture et partage avec le lecteur
les doutes et les frustrations qui peuvent l'accompagner. Là encore,
loin de romancer son expérience, elle en montre plutôt le paradoxe:
écrire lui est nécessaire et vain à la fois. En effet, par ce
livre, elle maintient un lien verbale avec son père, elle crée de
la vie là où il n'y en a plus, mais cette vie-là a, elle aussi,
une fin: « Je voudrais retarder les dernières pages, qu'elles
soient toujours devant moi. Mais il n'est même plus possible de
revenir trop loin en arrière, de retoucher ou d'ajouter des faits,
ni même de me demander où était le bonheur. »
Si
le tout dernier passage de l'œuvre nous apprend que l'auteur a
toujours des difficultés à communiquer lorsqu'elle se trouve au
point de friction entre ses deux milieux sociaux, ce livre et ceux
qui suivront nous montrent qu'elle a su utiliser le langage pour
raconter le monde et se raconter, et toucher ses contemporains.
Annie
Ernaux